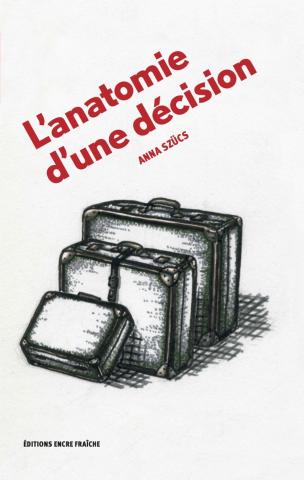Anna Szücs : L’anatomie d’une décision
C’est au célèbre château de Voltaire à Ferney que l’on présente prochainement le roman d’Anna Szücs, Suissesse partie à la recherche de ses origines hongroises. Son récit historique relate le cheminement décisionnel de ses grands-parents et de son père, confrontés à une problématique bien connue pendant la révolution de 1956 : quitter la Hongrie pour toujours, ou continuer de s’y exposer à un avenir qui redevient incertain. Le lieu de l’événement littéraire est donc bien trouvé : quelques siècles plus tôt, Voltaire avait établi ses quartiers à Ferney pour pouvoir franchir la frontière vers Genève en cas de menace de la part de sa patrie.
Nous avons rencontré Anna Szücs, jeune médecin et auteure aux talents multiples, à la veille de la présentation de son livre.
JFB : Avec L’anatomie d’une décision, vous relatez l’hésitation de votre famille entre quitter la Hongrie et rester dans leur ville de province, Zalaegerszeg, au moment de l’insurrection en octobre 1956. Les personnages et les événements sont-ils tous basés sur des faits réels ?
Anna Szücs : C’est le cas pour la majorité d’entre eux. Le roman a été construit autour de deux souvenirs que mon père me racontait souvent quand j’étais petite. Il s’agit des deux moments forts du récit : la complication principale et le dénouement final. Pour le reste, j’ai dû reconstituer les détails sur la base de comptes-rendus historiques, d’archives d’époque et de nos autres anecdotes familiales, mais toujours dans un dialogue avec mon père, qui validait la plausibilité des descriptions et de la trame narrative au fur et à mesure que j’avançais avec l’œuvre. Les personnages ont donc aussi existé pour la plupart, avec plus ou moins de différences par rapport à la réalité. Les lecteurs curieux peuvent d’ailleurs découvrir à quoi ils ressemblaient véritablement sur ma page web dédiée au roman : bit.ly/roman-anatomie. Mon but restait avant tout de créer une œuvre de fiction captivante, mais là où je pouvais me le permettre, je voulais reconstituer l’époque et ses protagonistes aussi fidèlement que possible, car écrire ce livre me permettait aussi de m’immerger dans l’univers des miens, qui me serait autrement resté inaccessible au vu de mon âge plus jeune.
 JFB : Quel était la situation sociale de votre famille dans la Hongrie de 1956 ? Et avant ?
JFB : Quel était la situation sociale de votre famille dans la Hongrie de 1956 ? Et avant ?
Anna Szücs : Mes grands-parents étaient issus de familles de commerçants juives aisées. La famille de mon grand-père possédait un commerce de grains plutôt important, avec des partenaires commerciaux qui s’étendaient au-delà des frontières hongroises. Le père de ma grand-mère avait un atelier de tailleur pour hommes dans la rue principale de Keszthely. Mes grands-parents avaient donc une situation sociale confortable jusqu’à la guerre, on peut dire qu’ils ne manquaient de rien. L’Holocauste a néanmoins ravi la majeure partie de leurs familles respectives ainsi que leurs fortunes. Au moment du récit en 1956, mon grand-père travaille comme sous-directeur aux Magasins du peuple (le Népbolt) de Zalaegerszeg. Il n’est pas membre du Parti et préfère rester discret. Mes grands-parents mènent une existence plutôt banale avec mon père qui a alors neuf ans. Ils habitent dans un petit deux pièces au centre de Zalaegerszeg. Ils n’abordent pratiquement pas leur vie d’antan, ni entre eux, ni avec d’autres. Sans doute s’agit-il de souvenirs douloureux, mais aussi de sujets tabous dans une ville où tout le monde sait tout sur tout le monde, et où la pression idéologique et la culpabilité collective ne permettent pas d’exprimer des regrets pour son passé.
JFB : La famille a compris trop tard sa situation tragique en 1944 et l’existence des camps de concentration où leurs parents, frères, sœurs, neveux et nièces ont péri. Quelles étaient les conséquences psychologiques de ce vécu dans leur processus décisionnel ?
Anna Szücs : En écrivant le roman, j’ai réalisé à quel point le silence qui a suivi la Seconde Guerre a dû entraver la guérison psychique de mes grands-parents, et des juifs hongrois en général. Ils ne pouvaient qu’enfouir les souvenirs des drames qu’ils avaient subis, à la place de les extérioriser. Nous savons aujourd’hui que cela ne permet pas de résoudre les traumatismes dans la plupart des cas, ou du moins pas sans laisser un fond d’anxiété qui s’empire lors de nouveaux événements de vie inquiétants. À travers mon travail en psychiatrie aux Hôpitaux Universitaires de Genève, j’ai eu l’occasion de suivre en consultation bon nombre de requérants d’asile : des victimes de guerre, de génocide ou d’autres formes de violence. Constatant à quel point la présence d’un espace de parole leur était importante au début de leur processus de guérison psychique, il me semble toujours aussi stupéfiant que mes grands-parents, et bien d’autres dans leur cas, aient pu rétablir leur existence sans bénéficier de ce genre de soutien. Au vu des souvenirs de mon père, je suis néanmoins convaincue que la guerre a dû changer mes grands-parents de jeunes adultes plutôt insouciants en des personnes inquiètes de nature. La réaction d’angoisse que l’insurrection de 56 génère chez eux est selon moi en grande partie expliquée par cela, ainsi que par le regret persistant de ne pas avoir quitté la Hongrie à temps dans les années 40. Ils ne s’aperçoivent pas tout à fait à quel point cette charge émotionnelle pèse lourd dans la balance lors de ce nouveau dilemme entre partir et rester.
 JFB : Des réfugiés hongrois étaient bien accueillis en Europe et en outre-mer en 1956. Depuis, d’autres peuples ont dû quitter leur pays. Comment voyez-vous le destin des réfugiés de nos jours et leur intégration ?
JFB : Des réfugiés hongrois étaient bien accueillis en Europe et en outre-mer en 1956. Depuis, d’autres peuples ont dû quitter leur pays. Comment voyez-vous le destin des réfugiés de nos jours et leur intégration ?
Anna Szücs : Pendant la guerre froide, les pays de l’Ouest percevaient les réfugiés hongrois comme des preuves vivantes de la supériorité du capitalisme sur le communisme. Ces réfugiés devaient réussir dans les pays capitalistes, car c’était leur réussite qui allait prouver son erreur au Bloc de l’Est. On leur a donc grandement facilité l’insertion, tout en éprouvant du dépit s’ils finissaient par repartir en Hongrie lorsqu’ils pouvaient de nouveau le faire. La situation avec les réfugiés contemporains est toute autre malheureusement : l’Europe les voit comme un fardeau, et l’idée populaire reste que quoi que nous leur offrions, nous sommes déjà plus généreux que ce que nous devrions être. Les Européens oublient souvent que la grande majorité des requérants d’asile ne seraient pas partis de chez eux s’ils avaient pu s’y sentir en sécurité. Il faut en principe passablement de souffrance et de peur pour convaincre un être humain d’abandonner ses racines, ses proches et sa patrie pour toujours. La majorité des réfugiés que j’ai rencontrés, même les plus fragiles sur le plan psychiatrique, ne demandaient qu’à pouvoir travailler et à se trouver une place dans notre société. Ceux qui sont en mesure de le faire se remettent généralement plus vite de leur vécu traumatique. Or, trop souvent, nos gouvernements préfèrent financer l’entretien complet de ces personnes plutôt que de leur permettre une telle insertion, de peur qu’ils s’éternisent. Je pense que nous gagnerions en économies et en richesses culturelles si leur processus d’insertion était davantage facilité.
JFB : Revenons à votre roman. Comment avez-vous entamé le travail de l’écrire et qui vous a aidé à le mener à bien jusqu’à sa parution ?
Anna Szücs : J’ai su que je voulais devenir écrivain depuis que j’ai appris à écrire à cinq ans. Au collège (équivalent du lycée dans le canton de Genève), nous avions la possibilité de réaliser un projet librement choisi comme travail de fin d’étude, et il m’a semblé que c’était l’occasion idéale pour m’essayer à l’écriture. J’avais rapidement décidé que le thème devait être en lien avec ma famille. En grandissant, j’ai toujours regretté la distance qui me séparait d’eux. Il s’agissait d’une distance géographique, comme nous habitions en Suisse avec mes parents et ma sœur, mais aussi temporelle, comme je suis une enfant née tardivement, et que bon nombre de mes proches étaient déjà décédés au moment où j’ai vu le jour. C’est ainsi qu’est née la première version de L’anatomie d’une décision. Or, ce n’est que neuf ans plus tard, déjà médecin, que j’ai redécouvert ce texte par hasard. En le relisant, j’ai senti qu’il mériterait d’être plus qu’un projet scolaire, et j’ai alors eu la chance d’obtenir une réponse favorable des Éditions Encre Fraîche quant à sa publication. On me suggérait néanmoins d’étoffer le récit. En reprenant ma plume en main (ou plutôt mon clavier d’ordinateur), j’ai été ravie de réaliser que mon expérience de vie et les connaissances professionnelles (notamment psychiatriques) gagnées entre temps me permettraient de lui donner une profondeur nouvelle. En plus de mon père qui m’aidait pour le contenu du récit, j’ai aussi tiré profit des conseils avisés de mon éditeur au niveau de sa forme. Finalement, j’ai choisi de réaliser une série d’illustrations pour accompagner le texte, aussi une expérience nouvelle pour moi qui ne dessinais jusque-là que pour mon propre plaisir. La réalisation de ce roman a donc été une aventure formidable à bien des niveaux. À travers ce projet, j’ai pu explorer une époque inaccessible bien que pas si lointaine, mieux connaître ma famille et mes racines, mais aussi me familiariser avec le métier d’écrivain et de dessinatrice, ce qui m’a donné envie de poursuivre ces activités plus sérieusement dans l’avenir. Comme quoi, je ne m’étais pas trompée à cinq ans.
JFB : Quels sont vos projets d’écrivain et de dessinatrice et comment faites-vous pour les concilier avec votre vocation de médecin, et de chercheuse ? Comment parvenez–vous à conserver votre culture hongroise ?
Anna Szücs : J’ai tendance à m’intéresser à beaucoup de choses en même temps, tout en étant perfectionniste dans ce que j’entreprends. Avec les années, j’ai appris qu’il n’était hélas pas toujours possible de faire tout ce qui m’intéressait en parallèle. J’ai eu jusqu’à maintenant une vie adulte riche en expériences diverses. La psychiatrie clinique et mon travail de recherche sur la personnalité dans la prise de décision m’ont énormément appris sur l’être humain. J’ai grandi à Genève, en Suisse, une ville et un pays qui j’affectionne beaucoup. J’ai pourtant gardé un lien fort avec la Hongrie. J’essaie d’y retourner chaque année et m’y sens chez moi. J’ai toujours beaucoup aimé parler et lire en hongrois. Je m’efforce de ne pas perdre mon vocabulaire et ma prononciation malgré le peu de temps que j’y passe. Il s’agit d’une partie importante de mon identité, et ce depuis toute petite. Plus récemment, j’ai aussi pu explorer d’autres cultures, en accompagnant mon mari qui s’est construit une carrière académique dans le domaine de la robotique. Ensemble, nous avons passé deux ans aux États-Unis, à Pittsburgh, et depuis peu, nous habitons à Singapour. Dans cette nouvelle étape de vie, je compte accorder plus de temps à l’écriture et au dessin, idéalement à côté d’une activité à temps partiel de médecin chercheur. Je sens que j’ai beaucoup de matière à mettre sur papier. Plusieurs idées de livres se profilent actuellement dans ma tête : un autre roman historique, une œuvre de fantasy, mais aussi des fictions plus réalistes et contemporaines. Il m’est encore difficile à dire dans quel ordre je parviendrai à les concrétiser. Du reste, mon père a entrepris la traduction hongroise de L’anatomie d’une décision, ce qui me permet aussi de mener plus loin ce premier projet, qui me tiens toujours autant à cœur.
Propos recueillis par Eva Vamos
- 172 vues